
Haïti : Quelles politiques face à la crise économique ?
Après la crise sanitaire, la crise économique va prendre son autonomie. Se posera alors la question de la stratégie pour éviter le « bain de sang social en Haïti » qui s’annonce. Faudra-t-il sauver tous les emplois ? Laisser le marché choisir ? Ou prendre une autre voie ?
Haïti fait face à une catastrophe humanitaire et une grande famine menace ce pays si rien n’est fait. Malheureusement, nous avons affaire avec des dirigeants criminels, assassins, corrompus et incompétents qui participent dans tous les crimes haïtiens.
Alors, ces dirigeants haïtiens sont en train de mettre en place une machine pour préparer des élections frauduleuses, avec des milliers de gangs armés sur tout le territoire d’Haïti.
Après la crise sanitaire, la crise économique semble inévitable. Car, malgré les chiffres catastrophiques du PIB, cette crise économique n’a pas encore réellement débuté. La structure économique est pour le moment largement suspendue pendant la diffusion du coronavirus. Mais, progressivement, la dégradation économique va prendre de l’ampleur et entrer dans une logique propre.
La crise sanitaire a contribué à stopper net le fonctionnement de l’économie marchande. L’État a pris le relais et a assuré le maintien d’un semblant de fonctionnement « normal » par deux moyens principaux : la garantie d’une partie des revenus via le chômage partiel, et le fonds de soutien aux indépendants et des prêts garantis censés compenser la perte de chiffre d’affaires des entreprises.
Ainsi, le circuit économique est-il maintenu tant bien que mal en vie par la grâce des autorités politiques : en théorie, les ménages peuvent consommer ce qui peut encore l’être, payer leurs loyers et acquitter leurs diverses factures, tandis que les entreprises peuvent conserver leurs effectifs, payer leurs fournisseurs et assurer un minimum de production. Mais ce circuit n’est possible non plus parce que les échanges de biens et services lui donnent les moyens de fonctionner, mais seulement parce que l’État s’est substitué au marché comme source de financement primaire.
Ce système assez inédit en régime capitaliste en dehors des périodes de guerre totale (mais le circuit est cependant différent) se justifie largement par le fait que le confinement et la limitation des transactions sont le fruit d’une décision politique. Mais il convient de ne jamais oublier la nature réelle de cette forme de socialisme qui s’est soudain mise en place à la mi-mars dans la quasi-totalité du monde. Il ne s’agit pas d’intervenir sur la production, comme c’est le cas par exemple en période de guerre, mais bien davantage de la préserver par une forme de « congélation » de l’économie. On ne modifie rien à l’existant – ou seulement à la marge –, on préserve avant tout dans l’optique d’un retour « à la normale ».
La logique à l’œuvre est donc celle-ci : une fois la menace sanitaire levée, les revenus ayant été préservés, la consommation « compensera » sa retenue liée au confinement et permettra alors aux entreprises de reconstituer leurs marges et leurs niveaux d’activité. Cette stratégie a été choisie en France (comme dans la plupart des autres États) dans les premiers jours du confinement, au moment où beaucoup estimaient que la crise sanitaire serait courte et qu’il ne s’agirait donc que d’une courte parenthèse.
Mais il n’est pas certain que si les autorités avaient su que la crise sanitaire devait être si longue et le coronavirus si difficile à maîtriser, elles se seraient lancées dans la même logique. Car, le temps passant, cette « congélation » n’empêche pas la dégradation des capacités de rebonds de l’économie.
Comment la crise économique va prendre son autonomie
Du côté de l’offre, les restrictions concernant le travail (plans sanitaires, aménagements divers) et les perturbations des chaînes d’approvisionnement qui doivent toutes redémarrer dans le monde à des rythmes différents vont forcément réduire la capacité productive des entreprises, alors même que certains secteurs vont demeurer durablement « confinés » par le maintien de l’interdiction d’exercer, notamment dans le domaine du spectacle et de la restauration. Certes, le chômage partiel permet de transférer sur l’État une grande partie du coût salarial et le report des échéances de loyers, de prêts existants et de cotisations sociales et des impôts directs peut réduire les dépenses à court terme, tandis que les prêts garantis par l’État ont vocation à combler l’absence de revenus. Mais l’absence complète de chiffre d’affaires ne saurait être entièrement « effacée » par ces moyens. Il faudra rembourser les prêts nouveaux et anciens et finir par acquitter les factures. Ce qui est perdu est perdu : nécessairement, il faudra ajuster l’offre à cet événement afin de préserver la rentabilité.
Pendant plusieurs mois, les entreprises vont donc chercher à assurer leur survie. Cela signifie que l’investissement va être mis en sourdine. D’autant plus que la visibilité sur l’avenir reste faible. Face à un gouvernement qui n’exclut pas des retours au confinement et une pandémie qui pourrait durer au moins deux ans, les entreprises ne peuvent prendre le risque d’immobiliser des sommes importantes dans des dépenses de structure.
Cette prudence aura forcément également un impact sur les effectifs. La perte de chiffre d’affaires pendant le confinement, la lente reprise et les coûts nouveaux vont conduire bon nombre de sociétés à chercher un point de rentabilité plus bas, donc à ajuster par l’emploi. Car la demande ne va pas repartir comme au 15 mars, loin de là. Certes, comme l’a montré l’OFCE, le confinement a nécessairement réduit les dépenses et donc constitué une forme « d’épargne forcée » en ne permettant pas un comportement habituel de consommation. Mais pour autant, cette épargne estimée par l’institut à 55 milliards d’euros ne sera pas dépensée immédiatement. D’abord, parce que, comme on l’a vu, l’offre ne suivra pas toujours et ensuite parce que l’incertitude est si forte sur l’avenir que la tentation de conserver une forte épargne de précaution sera à la mesure.
Par ailleurs, le chômage partiel ne compense pas intégralement les revenus des ménages concernés. Au-delà du salaire minimum, l’indemnité s’élève à 84 % du salaire et ne prend en compte que 35 heures travaillées. Les revenus des salariés baissent donc pendant le confinement et une grande partie d’entre eux n’auront donc qu’une capacité « d’épargne forcée » faible, d’autant que loyers et factures restent dus pour les particuliers. Dès lors, ces ménages seront tentés de réduire leurs dépenses pour faire face au présent et aux risques de nouveau confinement ou de pertes d’emploi à l’avenir. Comme le chômage ne va sans doute cesser de progresser (et qu’il a commencé à faire compte tenu de l’absence complète de nouvelles offres), cette tendance va s’accroître. Dans ces conditions, la demande de biens durables et de certains services pourrait rester faible.
Le double choc d’offre et de demande pourrait donc conduire rapidement à une crise durable selon un schéma classique : les entreprises chercheront à survivre et à reconstituer leurs marges et licencieront, ce qui réduira le niveau de demande et conduira à des faillites et de nouveaux licenciements. Autrement dit, la crise économique d’origine sanitaire et politique se doublera d’une « vraie » crise économique, propre à un système qui va s’ajuster à une demande plus faible. L’économie marchande sera à la recherche d’un nouvel équilibre qui sera largement inférieur en termes de niveau de vie général à celui de l’avant-crise.
Déjà les menaces se précisent, la situation sociale, maintenue tant bien que mal pendant quelques semaines, se dégrade à grande vitesse. Le chômage explose puisqu’il n’existe plus d’offres d’emploi pour les nouveaux arrivants. Les plus fragiles et les plus précaires commencent à souffrir directement des restrictions de revenus et de l’absence de travail. La crise économique commence à prendre sa propre autonomie. Elle ne dépend plus seulement de la seule crise sanitaire, elle s’auto-entretient. Et le règlement même de la crise sanitaire ne sera plus le seul sésame au règlement de la crise économique.
Le retour aux vieilles recettes ?
Comment éviter un tel scénario ? C’est là la réponse centrale à laquelle le gouvernement doit répondre et qui exige d’ajuster sa stratégie. Il tarde à le faire. Les deux projets de lois de finances rectificatives (PLFR) ont ajusté les dépenses de l’État aux manques du secteur privé au fur et à mesure que ces dernières intervenaient. Ici ou là, on colmate les brèches sociales qui apparaissent : une prime exceptionnelle pour les plus précaires (titulaires du RSA ou de l’ASS) et une aide de 200 euros pour les moins de 25 ans, comme l’annonçait le 4 mai Édouard Philippe. Mais cela ne répond pas réellement à la question de la crise économique et sociale à venir. De même, devant le Sénat, Édouard Philippe a annoncé le maintien de certaines dispositions concernant les entreprises et même, dans certains cas, la suppression des charges fiscales et sociales. Mais tout cela n’est valable que durant le confinement ou la période transitoire, jusqu’à la fin juin. On est encore dans la gestion des conséquences propres à la crise sanitaire.
En termes de stratégie, le gouvernement tient un discours qui trahit une politique à courte vue. D’un côté, il met en garde contre la durée et la force de la crise, de l’autre, il prétend chercher à faire repartir le plus vite possible « l’économie », autrement dit le fonctionnement marchand, autonome, du système productif. Or, cette reprise ne peut se faire, comme on vient de le voir, que dans une spirale négative. L’exécutif est pressé d’en finir avec le « socialisme de congélation » qui prévaut durant le confinement. Mais il ne peut espérer que ce redémarrage de « l’économie » ne se traduise par une plus faible dépendance de cette dernière à l’égard de l’aide publique.
En réalité, la vraie question est bien de savoir jusqu’où maintenir cette tutelle de l’État sur l’économie marchande. La première réponse, évidente, est que l’horizon du soutien public est l’apaisement de la crise sanitaire. « L’état d’urgence sanitaire » justifie effectivement ce soutien puisqu’il suppose des fermetures administratives et des contraintes légales. Mais ensuite ? Une fois l’exceptionnel passé ? Comment traiter la « crise économique » autonome ?
La première tentation peut être, parce que l’on croit à l’ajustement « naturel » de l’économie, de lever rapidement les aides exceptionnelles de l’État aux ménages et aux entreprises. En finir avec les mesures actuelles de chômage partiel et les autres mesures de soutien et laisser le système s’ajuster. Comme le néolibéralisme contient un élément keynésien, ce choix n’est pas nécessairement incompatible avec des mesures de « relance » pour que, en soutenant la demande, on parvienne à trouver un équilibre moins douloureux socialement. C’est sans doute l’idée du gouvernement qui a annoncé un « plan de relance » pour septembre, sans entrer dans le détail.
Les investissements publics pourraient ainsi venir compenser l’atonie de la dépense privée. Dans un tel schéma, il faudra que le travail s’adapte à la nouvelle donne. On aura donc des licenciements dans certains secteurs, selon le schéma présenté plus haut, et des embauches dans d’autres, ceux stimulés par la demande publique. L’enjeu sera donc d’assurer les vases communicants par un marché du travail fluide et des « incitations ». C’est pourquoi le gouvernement n’a pas renoncé à sa réforme de l’assurance-chômage reportée à l’automne. C’est aussi pourquoi il tient encore dur comme fer aux précédentes réformes du marché du travail.
Il existe donc des indices que cette politique sera celle du gouvernement. Mais elle présente de nombreux risques. La plus importante sera celle de l’ampleur et de la nature du stimulus budgétaire. Au regard des économistes qui conseillent l’exécutif dans ce schéma, on doit principalement s’attendre à des baisses d’impôts (et c’est bien pour cela que le gouvernement refuse d’engager un débat sur la politique fiscale) ou à des partenariats public-privé. Dans un contexte où le « coût » du confinement sera déjà lourd, il est possible également que ces aides soient ciblées et réduites.
Dans ce cas, il est probable que la faiblesse de la relance, son caractère ciblé et le biais fiscal, ne débouche que sur un soutien insuffisant. Les baisses d’impôts ne seront pas réinvesties dans l’économie productive qui restera sans perspective (alors que les marchés financiers se porteront bien), les incitations fiscales n’ont jamais remplacé des investissements et « l’économie » aura besoin d’une relance massive et générale et non ponctuelle. Dès lors, que se passera-t-il ? La demande demeurera faible, les emplois créés seront insuffisants. Les ménages réduiront toujours leurs dépenses et les entreprises feront faillite. Le cercle dépressif se déploiera et la « relance » aura finalement creusé encore davantage le déficit public, ce qui pourrait à tout moment valider l’option d’une nouvelle politique d’austérité qui alimentera encore la crise.
Cette option fait en effet fi d’un élément clé : le capitalisme, avant la crise sanitaire, n’était pas vaillant. Et l’économie française ralentissait depuis plusieurs mois, l’amélioration des chiffres de l’emploi ne s’expliquant que par la dégradation de la productivité. Ces faits sont largement niés au sein du gouvernement où l’on commence à décrire le début de l’année comme un « paradis perdu ».
Ceux qui nient ce ralentissement structurel du capitalisme, notamment Gilbert Cette et Philippe Aghion, deux économistes proches d’Emmanuel Macron, vont voir dans la crise actuelle un moyen d’accélérer la « destruction créatrice » en favorisant la « numérisation de l’économie ». Dans un article récent de blog sur le site de la Banque de France où il est économiste, Gilbert Cette défend l’idée que la crise actuelle « pourrait favoriser le déploiement de l’économie numérique, ce qui dynamiserait la productivité et la croissance ». On voit le schéma du plan de relance de l’automne se dessiner : des aides pour les start-up, des soutiens à « l’innovation digitale », des baisses d’impôts pour les plateformes numériques. Cette vision consiste à laisser le marché décider des emplois à créer et à détruire. C’est sans doute sur cette base que la politique économique restera fondée après la crise sanitaire.
Mais il existe le risque, non négligeable, que cette « économie numérique » ne favorise ni la croissance ni la productivité, mais plutôt l’emploi bas de gamme, mal payé et précaire. Et donc conduise à une atonie de la croissance qui nécessite de « nouvelles réformes ». Au reste, depuis vingt ans, l’économie numérique s’est incontestablement déployée, quoi qu’en dise Gilbert Cette, et c’est bien le contraire de ce qu’il prédit qui est advenu : moins de croissance et de croissance de la productivité. On peut penser que plus de numérique inversera la vapeur. On peut aussi, en toute rationalité, penser le contraire. Et dans ce cas, une politique qui compterait sur ce type de vieux ressorts serait un désastre social. Il est toujours utile de se souvenir qu’en 2008, la croissance n’a pas été soutenue par le « numérique », mais par l’hypercroissance chinoise, laquelle a conduit à une surproduction de produits polluants comme l’acier ou le ciment. Ce type de « sauvetage » n’est ni possible ni souhaitable. La stratégie de relance à l’ancienne semble donc à la fois limitée et dangereuse.
Faut-il empêcher à tout prix les faillites ?
Que faire alors ? Face à cette urgence, on pourrait aussi poursuivre la « congélation » de l’économie avec le soutien de l’État. Si cette option est moins probable que la précédente, elle n’est pas impossible dans la mesure où, avec le soutien de la BCE, les moyens publics sont considérables et où, surtout, les frontières entre crise sanitaire et crise économique risquent de demeurer floues pendant longtemps.
Dès lors, pourquoi ne pas tout faire pour éviter les faillites des entreprises et préserver l’emploi ? On peut donc imaginer que, pour que l’ajustement à la baisse soit moins violent, on poursuive et même on élargisse le système de chômage partiel pour se substituer aux entreprises dans le paiement des salaires, avec, par exemple, l’élargissement des aides directes aux entreprises et des prêts garantis par l’État.
L’argument en faveur d’une telle politique est solide : en empêchant les faillites et donc les suppressions d’emplois, on freine cette spirale autonome de la crise économique. On soutient la demande en évitant de laisser tomber dans la misère et l’incertitude beaucoup de salariés et on favorise à la fois les dépenses des ménages, moins inquiets pour leurs emplois, et l’investissement des entreprises, rassurées par la capacité de consommation future des ménages et par leur propre survie. Une fois le tissu économique préservé, le plan de relance nécessaire pour retrouver un équilibre socialement soutenable sera sans doute moins fort que dans le premier cas.
Dans ce cas, pour faire simple, l’intérêt des entreprises particulières deviendrait l’intérêt général. Et la politique sociale consisterait donc à éviter les faillites. C’est au reste l’évidence : l’effondrement social des États-Unis qui, en un mois et demi, a vu le nombre de chômeurs augmenter de 30 millions est un puissant contre-exemple de ce que ne rien faire impliquerait. Le régime de substitution de l’économie marchande par l’État devrait alors se maintenir jusqu’à ce que cette dernière ait repris son autonomie.
Cette politique est en partie celle de l’État puisque le gouvernement a réservé 20 milliards d’euros au sauvetage d’entreprises particulières, dont 7 milliards d’euros pour Air France, au nom de la sauvegarde des emplois, et notamment des emplois des sous-traitants. On pourrait donc imaginer un élargissement de cette politique, notamment mais pas seulement par le chômage partiel.
Mais là encore, cette politique comporte des risques. Éviter les faillites ne signifie pas toujours sauver les emplois. D’ailleurs, les aides gouvernementales ne sont pas soumises au maintien de l’emploi, mais, comme dans le cas d’Air France, au « rétablissement de sa compétitivité ». Autrement dit, pour que l’État finisse par se désengager, il faudra que l’entreprise réduise ses coûts et donc ses effectifs. La politique de protection contre la faillite conduit donc à cet élément paradoxal que l’on « aide » une entreprise à licencier. Certes, la perte d’emplois est plus faible que dans le cas d’une faillite pure et simple, mais ce n’est bien qu’une politique du « moindre mal » qui réduit son efficacité macroéconomique.
Enfin, une politique globale de sauvetage des entreprises pour sauver les emplois ne résout pas la question de la future politique économique. Pour continuer à sauvegarder les emplois « sauvés » par l’État, il faudra que ce dernier continue de prendre soin des entreprises, mais cette fois non plus par une garantie directe de leur survie, mais par une garantie de leurs bénéfices. Cela passera logiquement par une fiscalité favorable, une réduction des contraintes légales et une libéralisation du marché du travail. La contrainte sanitaire et sociale laissera place à la contrainte concurrentielle. Et pour favoriser la compétitivité et l’innovation, l’État devra se mettre à nouveau au service du capital contre le travail.
Ce processus sera d’autant plus facile qu’il s’appuiera sur les leçons de la crise : on aura gravé dans le marbre le « chantage à l’emploi » des entreprises qui n’aura donc aucune raison de cesser et qui est un des principaux moteurs des politiques néolibérales. Cette politique pourrait être la confirmation d’une identité entre l’intérêt des entreprises et l’intérêt général. Au reste, là encore, la méthode utilisée pour attribuer les aides actuelles le prouve. Le gouvernement, sous la pression de l’opinion, avait envisagé l’idée de conditionner l’aide publique à la non-présence dans les paradis fiscaux. Il y a vite renoncé car refuser l’aide sur ce critère conduisait à abandonner trop d’entreprises. Autrement dit, on a placé le principe de la sauvegarde de l’emploi par les entreprises existantes au-dessus de toutes les autres considérations. Mais, ce faisant, on sauve surtout le capital et les intérêts des propriétaires des entreprises.
Certes, certains peuvent légitimement croire qu’une fois que le pire de la crise sera passé, il sera temps de demander des comptes au secteur privé au nom même de ce sauvetage. On peut songer aux thèmes à la mode ces temps-ci, comme la réduction de l’évasion fiscale, l’orientation écologique et les relocalisations de la production. Mais il est aussi permis de douter que ce type de compensation soit simplement possible. Car les entreprises ne goûtent guère le poids de la reconnaissance. Et puisque l’on a établi le socialisme temporaire pour « sauver les emplois », il sera tout aussi urgent d’assurer une phase de libéralisation pour « créer des emplois ».
Une fois la crise passée, la logique d’accumulation reprendra ses droits. Les entreprises devront être plus rentables et toute la politique économique sera à nouveau concentrée sur cette exigence sous le drapeau à nouveau déployé de la « croissance ». Finalement, le chantage à l’emploi n’aura changé que de forme, pas de nature. Là où la crise obligeait l’État à protéger les entreprises de la faillite au nom de l’emploi, la croissance obligera l’État à lever les contraintes pesant sur ces mêmes entreprises au nom de l’emploi.
Il ne faut jamais négliger ce que l’économiste indien Kaushik Basu appelle le « point focal » en économie. En fonction de l’obsession dominante, les exigences peuvent être fort différentes, y compris au sein d’un même corps social. Voilà trois mois, le patronat ne trouvait pas de mots assez durs pour condamner un État français trop lourd et source de croissance faible. Il a ensuite exigé un secours général et complet des entreprises. Il ré-exigera au nom de l’emploi ce qui lui est favorable.
Changer de logique : une nouvelle politique économique
Dès lors qu’on laisse aux impératifs du marché le soin de créer des emplois, l’action publique ne peut être que le simple adjuvant de ces impératifs. En termes encore plus clairs : si c’est l’accumulation de capital qui crée les emplois et si l’on croit que « l’économie » se limite à ce besoin infini d’accumulation, alors effectivement, la fonction de l’État n’est que d’accompagner cette recherche du profit, en se substituant à elle lorsqu’elle n’est plus possible et en lui donnant les moyens de s’épanouir par temps calme. C’est, au fond, le cœur de la pensée néolibérale qui a été à l’œuvre en 2008 et qui se renouvelle aujourd’hui.
C’est pourquoi il semble nécessaire de tracer une troisième voie. La crise actuelle est d’une telle ampleur qu’elle invite à une réflexion radicale sur « l’économie ». Et la première serait de remettre en cause le triptyque économie-entreprise-emplois. Chacun de ces termes est en réalité problématique, et refuser de s’interroger sur leur signification revient à adopter une solution similaire à celle décrite auparavant.
« L’économie » est, dans ce triptyque, comprise exclusivement comme l’économie privée capitaliste fondée sur l’accumulation. Dans ce cas, elle est « impérialiste » : elle impose ses propres priorités au reste de la société et, comme on l’a vu, elle le fait par l’emploi. Ce dernier n’est alors conçu que comme le produit de l’activité d’une entreprise elle-même soumise à cette loi d’airain du capital, et qui ne peut survivre que par le profit. Dès lors, effectivement, comme le prétendent les observateurs libéraux, le confinement était un « suicide collectif ». On a cassé la capacité à réaliser du profit et cela se paie immédiatement en emplois et donc en bien-être.
Si l’on veut échapper à cette logique, il faut donc concevoir l’économie autrement. Il ne faut plus la voir comme ce qui impose à la société sa loi, mais comme ce qui permet d’abord de répondre à des besoins sociaux définis en commun. Dès lors, tout change. L’économie n’est plus cette puissance impériale, c’est un outil. L’entreprise prend également une autre fonction : elle n’est plus ce moyen de valoriser un capital, mais elle devient un collectif de travail qui répond à des besoins. Et l’emploi n’est plus dépendant des nécessités de l’accumulation, mais des besoins sociaux.
Dès lors, la question du sauvetage des entreprises prend une forme entièrement nouvelle. Conformément à cette nouvelle logique, le besoin de la société domine l’action publique. La priorité n’est donc pas de sauver les emplois en soi, mais d’assurer la satisfaction de ces besoins.
La première des priorités doit être de permettre à chacun de vivre dignement. Il faut donc déployer un filet de sécurité sociale universel, capable de rassurer chacun sur la perte de son emploi. C’est finalement ce que l’on fait avec le chômage partiel, mais le chômage partiel s’attache d’abord à sauvegarder l’entreprise. Ici, on peut imaginer que l’État refuse d’aider certaines entreprises en posant des conditions strictes : bilan carbone, recours aux paradis fiscaux et aux délocalisations, financiarisation de la structure, politique de dividendes. Dès lors, deux possibilités peuvent se présenter : la reprise par les salariés avec l’aide de l’État et le respect de ces conditions, ou la dissolution de l’entreprise et, dans ce cas, le maintien des conditions du chômage partiel.
Pour briser le chantage à l’emploi et assurer la satisfaction des besoins, la garantie de l’emploi proposée par certains, notamment Pavlina Tcherneva aux États-Unis, peut sembler une bonne solution. Les emplois privés n’ont plus alors à être assurés par l’État puisque l’État propose aux salariés un ensemble d’emplois d’intérêt général avec lequel ils peuvent vivre, se former et travailler. Évidemment, en période de pandémie, ces emplois ne sont pas forcément disponibles pour des raisons sanitaires, mais on peut les attribuer en attendant la fin de la pandémie, avec un versement de salaire, exactement comme le chômage partiel. Ce dispositif n’est pas, au reste, incompatible avec une assurance-chômage classique, mais permet de maintenir ceux qui le souhaitent en emploi.
L’existence de ce filet de sécurité permet d’en finir avec le « chantage à l’emploi ». Il oblige aussi l’État à prendre ses responsabilités en investissant réellement dans les activités d’intérêt général définies par les besoins délibérés en commun. Un tel système ne peut évidemment pas voir le jour dans l’urgence d’une crise, mais il est possible d’utiliser la crise pour le mettre en place en donnant la priorité, non pas au sauvetage du capital privé, sous couvert de sauvetage de l’emploi, mais bien davantage au maintien du niveau de vie des individus.
Dès lors, la faillite n’est pas le désastre que l’on nous décrit, c’est une forme d’expropriation causée par le fonctionnement même du système capitaliste. Personne n’a confisqué le capital à ses propriétaires, ce dernier a simplement perdu sa valeur. La puissance publique peut alors, si elle le juge utile, reprendre l’entreprise pour la diriger, comme un repreneur classique, dans une direction qu’elle définit elle-même. Mais si elle ne le juge pas utile, elle peut proposer des solutions aux salariés.
Si la priorité doit être donnée à l’évitement de la crise sociale plutôt qu’à sa simple gestion, alors il est fondamental d’utiliser la capacité d’action actuelle des pouvoirs publics pour redéfinir les relations entre l’économie et la société. Cela est possible, dans un premier temps par trois actions simples : conditionner l’aide aux entreprises, envisager la socialisation des entreprises et protéger les salariés par une politique sociale ambitieuse. L’autre terme de l’alternative, c’est la poursuite du chantage à l’emploi et de la soumission du corps social aux intérêts du capital.
Leave a Reply








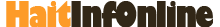



0 Comment